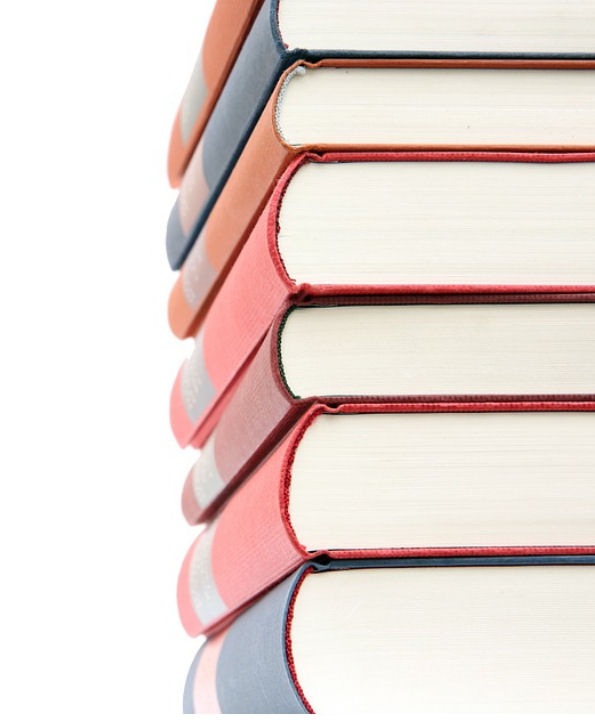Catégorie : Uncategorized
Cadeaux et Divorce
Lors d’un mariage, on s’échange des présents. L’un des plus importants en général c’est notamment la bague de fiançailles qui peut avoir une certaine valeur pécuniaire ou sentimentale. Les époux peuvent également recevoir des cadeaux de tiers.Le divorce entraine-t-il nécessairement le retour des cadeaux offert lors du mariage ?
Le présent d’usage
En principe, « donner c’est donner ». C’est le cas pour un présent d’usage, c’est-à-dire un cadeau offert à l’occasion d’un évènement, ou lorsque c’est un présent de petite valeur.
Ce peut être un meuble, un véhicule, un bibelot…Un présent d’usage ne fait pas partie de la communauté, il appartient en propre à celui qui le reçoit et il est définitivement acquit. Ainsi, l’époux à l’origine du cadeau ne pourra pas le récupérer.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
On évalue la valeur du cadeau au jour où il a été offert, peut importe qu’il ait pris de la valeur au moment du divorce.Néanmoins, pour récupérer un cadeau, un époux peut arguer de la valeur affective du bien donné. C’est le cas d’une bague de fiançailles ayant appartenu aux grands-parents de l’époux l’ayant offert. Ce dernier devra prouver cet attachement familial afin que le présent ne soit plus considéré comme un présent d’usage mais comme une donation faite à usage de prêt pendant le mariage. La restitution doit être demandée dès le début de la procédure de divorce, c’est-à-dire impérativement avant le prononcé du divorce. Toutefois, la restitution n’est pas systématique.
Les cadeaux reçus par des tiers
Les cadeaux ou donations reçus par des tiers n’ont pas à être inclus dans le cadre du divorce.
En effet, il est prévu par le Code civil que sont des biens propres par nature les biens qui ont un caractère personnel.
Ces donations sont donc irrévocables.
Que faire lorsque la convention de divorce est rejetée ?
CONVENTION DE DIVORCE REJETÉE
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par acte d’avocats. Chaque époux doit désormais disposer son propre avocat. Les avocats rédigent une convention de divorce réglant les intérêts personnels et financiers des époux. Une fois le projet rédigé, les avocats adressent à chacun de leur client, le projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de la réception de ces conventions, les époux doivent respecter un délai de réflexion de quinze jours incompressibles puis fixer un rendez-vous de signature en présence de leurs avocats. Une fois ces conventions signées, l’avocat le plus diligent les communique à un notaire pour enregistrement.
Article lié: LE DIVORCE SANS JUGE
La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article
Contrairement au juge, le notaire n’a pas de pouvoir de contrôle de fond des conventions de divorce mais doit s’assurer du respect de plusieurs conditions :
Le respect du délai de réflexion de quinze jours
Imposé par la loi, à compter de la réception des lettres recommandées entre cette réception et la signature des conventions : Si le délai n’a pas été respecté, le notaire rejettera la convention. Il appartiendra donc aux avocats respectifs de refaire parvenir un recommandé aux époux et fixer un nouveau rendez-vous de signature et s’assurer que le délai est respecté puis communiquer à nouveau les conventions au notaire.
Le contrôle des exigences formelles
Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
L’état liquidatif du régime matrimonial le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
S’il manque une seule de ces exigences formelles, le notaire doit refuser l’enregistrement et une nouvelle convention complète devra être rédigée. Une nouvelle lettre recommandée sera adressée et il faudra à nouveau respecter le délai de réflexion de quinze jours.
Le contrôle des annexes
Lorsque le mineur est en âge de discernement (vers 10 ans), celui-ci doit remplir un formulaire d’information indiquant qu’il a reçu l’information selon laquelle il peut être entendu par un juge si tel est son désir.
la présence des actes authentiques
Dans le cas où les époux disposent de biens soumis à la publicité foncière et faisant partie de la liquidation du régime matrimonial des époux, le notaire doit disposer de cet acte.
Dans le cas où un de ces actes est manquant, les époux doivent les communiquer au notaire.
Participation à l’activité de son ex-conjoint et divorce
COMMENT SE PASSE LE DIVORCE LORSQUE L’ON PARTICIPE A L’ACTIVITÉ DE SON CONJOINT ?
La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne entente est de mise durant la vie commune, les époux ne se prémunissent pas toujours contre les éventuels problèmes pouvant survenir lors d’une séparation. Ce statut particulier ne fait donc pas toujours l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme social qui aurait pu permettre une protection et des avantages plus accrus durant le mariage. Fort heureusement, le droit français offre des garanties pour protéger l’époux collaborateur.
La Collaboration à l’activité professionnelle : de quoi s’agit-il ?
Vous êtes conjoint collaborateur lorsque vous participez, de manière régulière, à l’activité au sein de l’entreprise de votre époux ou de la personne avec laquelle vous êtes pacsé, sans percevoir de revenu et sans bénéficier d’un statut particulier (associé, salarié). Toutefois, afin d’entrer dans ce régime, votre conjoint doit nécessairement être un chef d’entreprise individuelle ou un gérant associé unique d’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou d’un gérant majoritaire de SARL (société à responsabilité limitée) de moins de 20 salariés. Le statut de conjoint collaborateur est également ouvert au conjoint d’agent commercial et à celui du micro-entrepreneur. Il est a noté que les concubins ne peuvent être qualifiés de collaborateurs. L’accent est à mettre sur la fréquence de la participation. En effet, si vous avez une activité professionnelle extérieure à celle de l’entreprise, vous pourrez être présumé comme n’exerçant pas une activité de manière régulière au sein de la société de votre conjoint. Cette présomption pourra être renversée par toute preuve attestant du contraire.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Les avantages de collaboration à l’activité professionnelle durant la vie commune
Lorsque le statut est déclaré, le conjoint collaborateur bénéficie de nombreux avantages. La déclaration doit se faire auprès du CFE (Centre de formalités des Entreprises) ou bien de la chambre du commerce ou chambre des métiers. Ainsi le collaborateur bénéficiera d’une protection sociale et pourra cotiser pour sa retraite. Il pourra également représenter le chef d’entreprise au sein de la société. Toutefois, ce statut reste précaire et ne permet pas, par exemple, le versement d’allocation chômage. Le statut de conjoint collaborateur n’est pas le seul choix offert au chef d’entreprise. En effet, l’article L121-4 du code de commerce dispose que « Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. » Le conjoint salarié sera titulaire d’un contrat de travail et percevra un salaire mais ne devra pas être associé majoritaire et disposer de la signature bancaire. À contrario, le conjoint associé est non rémunéré. Il partage les bénéfices au prorata des parts détenues dans la société. Si vous n’appartenez à aucun de ces statuts, vous collaborez bénévolement à l’activité de votre conjoint. Ainsi, Vous ne cotisez pas pour la retraite et ne bénéficiez d’aucune couverture sociale. Cela donne également lieu à l’absence de versement d’un salaire et d’un quelconque lien de subordination. Il faut donc se montrer prudent : cette situation de travail non déclaré, qui ne crée aucun droit pour le conjoint aidant, est interdite par la loi et considérée par l’Urssaf comme un travail dissimulé.
Les conséquences en cas de divorce
L’article 270 du code civil dispose que « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »Le divorce peut créer un déséquilibre entre les deux époux. Si vous n’avez pas déclaré votre statut de conjoint collaborateur par exemple, le calcul de votre retraite et des éventuels autres droits pourra s’avérer complexe. Si vous optez pour un divorce contentieux devant un juge, (divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitif du lien conjugal), il sera tenu compte de la disparité du niveau de vie entre les époux pour le calcul de la prestation compensatoire. Le juge tiendra également compte de l’absence de couverture sociale et de la cotisation pour la retraite pour fixer cette indemnité. Vous pourrez donc prétendre à obtenir une prestation compensatoire importante si vous n’avez pas déclaré votre statut de collaborateur et si vous réussissez à prouver une activité régulière. En revanche, si vous décidez de passer par une procédure de divorce par consentement mutuel, vous devrez vous entendre sur le montant de la prestation compensatoire avec votre conjoint. Les époux doivent nécessairement tomber d’accord sur ce dernier s’ils désirent poursuivre dans cette voie. Tout contentieux à ce sujet mettra en échec une telle procédure. Toutefois, le divorce extrajudiciaire n’oblige pas la mise en place d’une prestation compensatoire. Cette décision appartient exclusivement aux époux qui décident de prendre en compte la disparité qui va intervenir après la dissolution du mariage ou de tout simplement y renoncer. Il est a préciser qu’il n’y a pas de méthode de calcul de la prestation compensatoire au sens strict du terme. En effet, il en existe plusieurs qui n’aboutissent pas toujours au même résultat et qui ne sont présentes qu’à titre indicatif. Vos avocats respectifs pourront donc être de très bon conseil afin de fixer un montant convenable.
REFUSER A UNE PENSION ALIMENTAIRE LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE AMIABLE
Pendant le mariage, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (article 203 du Code civil).La pension alimentaire représente un contentieux important dans un contexte de séparation ou de divorce. En effet, après le divorce cette obligation subsiste aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil. Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de renoncer à une pension alimentaire ?
Le caractère non obligatoire de la pension alimentaire
Tout d’abord, la pension alimentaire n’est pas obligatoire, celle-ci dépend des modalités de résidence de l’enfant. En principe, la pension alimentaire est versée par celui des deux parents qui n’a pas la résidence de l’enfant. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit dans son premier alinéa « qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». En revanche, en cas de résidence alternée, il est supposé que l’obligation alimentaire est assurée par les deux parents de manière équivalente.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
La pension alimentaire prend le plus souvent la forme d’une somme d’argent versée tous les mois. Elle est fixée soit à l’amiable, soit par le Juge aux Affaires Familiales, à l’aide d’un barème indicatif, en fonction des ressources et des charges du parent qui doit la verser et des besoins de celui à qui elle est due. En effet, lorsqu’une procédure de divorce se fait par consentement mutuel, les deux coparents soumettent eux-mêmes le montant de la pension alimentaire dans la convention de divorce contresignée par leur avocat. Les avocats jouent alors un rôle de conseil et apprécient le caractère raisonnable de la contribution. En cas de désaccord sur le montant de la contribution ou sur ses modalités de versement, le Juge aux affaires familiales devra alors rendre une décision pour fixer la pension alimentaire.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou, le cas échéant, à la personne à qui l’enfant a été confié. Sauf disposition contraire expresse, la pension alimentaire est due d’avance et elle doit être payée douze mois sur douze, y compris pendant les vacances au cours desquelles le débiteur héberge les enfants. Et le versement de la pension alimentaire doit se faire même si le débiteur ne peut pas voir les enfants, l’exercice du droit de visite et d’hébergement est totalement indépendant du paiement de la contribution.(…) suite de l’article
L’impossibilité de renoncer à une pension alimentaire
En toute hypothèse, le droit d’obtenir une pension alimentaire est d’ordre public. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2012 n° 11-19779 a rappelé que « les règles gouvernant l’obligation alimentaire étant d’ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d’un parent au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ou au versement des arriérés dus au titre de celle-ci, est sans effet ». Ainsi, il n’est pas possible de renoncer à une pension alimentaire. Même si les parents décident d’un commun accord de ne pas fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans leur convention de divorce, en cas de résidence alternée, il faut savoir qu’aucun des deux ne perd son droit de réclamer une pension alimentaire en cas de modification de leurs situations. Il a par exemple été jugé, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, que l’époux qui a renoncé au versement d’une pension alimentaire au moment du divorce, par l’insertion d’une clause dans la convention, en raison d’une insuffisance de revenus de l’autre parent, peut tout à fait l’exiger ultérieurement (2ème chambre civile de la Cour de cassation, 17 octobre 1985, BC n°157).En conclusion, il n’est pas possible pour les parents de déroger à leur obligation d’entretien, au même titre que ces derniers ne peuvent pas renoncer tacitement ou explicitement à la pension alimentaire pour leurs enfants.
DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT NON-RESPECTÉ PAR SON EX-CONJOINT
En cas de séparation des parents, l’article 373- 2 du Code civil prévoit que « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Lorsque les deux parents divorcent, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord ou par décision du juge aux affaires familiales. Il existe principalement trois types de fixation de résidence de l’enfant :
– Classique : lorsque la résidence est fixée chez l’un des parents et l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
– Alternée : lorsque la résidence est fixée en alternance, généralement une semaine/une semaine ;
– Réduit : lorsque la résidence est fixée chez l’un des époux et l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement réduit, par exemple, un week-end par mois.
Par conséquent, sauf en cas de résidence alternée, lorsque les époux ou le juge décident d’accorder la garde de l’enfant à l’un des parents, il est accordé, en contrepartie, un droit de visite et d’hébergement à l’autre parent.
Il arrive que le parent bénéficiaire n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cependant, comme son nom l’indique, il s’agit d’un droit et non d’une obligation pour ce dernier.
Quels sont alors les recours pour le parent gardien et l’enfant ?
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Les recours pour le parent gardien
Il est important de préciser que le droit de visite et d’hébergement ne doit pas être empêcher par le parent gardien. En effet, ce dernier doit toujours veiller à sa bonne application tant qu’il n’y a pas eu de révision du jugement ou de la convention de divorce. Dans le cas contraire, le parent bénéficiaire du droit pourrait saisir le juge aux affaires familiales pour non représentation d’enfant.
En cas de non-exercice du droit de visite et d’hébergement par le parent bénéficiaire, il est conseillé au parent gardien de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire réviser le jugement ou la convention de divorce. Il est alors important d’apporter des preuves comme le dépôt d’une main courante à chaque fois que le parent ne s’est pas présenté ou des sms échangés avec lui.
Il sera alors possible de prévoir de nouvelles modalités du droit de visite et d’hébergement voire une augmentation de la pension alimentaire en faisant valoir l’absence de participation du parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant, conséquence du non-exercice du droit.
En revanche, il est impossible de demander la suspension ou la suppression du droit de visite et d’hébergement s’il n’est pas respecté. La suppression n’est accordée dans des cas très rares tels qu’un mode de vie mettant en péril la santé et/ou la sécurité de l’enfant.
Les recours pour l’enfant
Il n’est pas rare que les enfants n’osent pas s’exprimer au moment de la procédure de divorce mais manifestent leur volonté de voir modifier les modalités mises en place plus tard.
L’enfant ayant la capacité de discernement peut alors demander à être entendu par le juge afin de demander la modification du droit de visite et d’hébergement. Concernant la capacité, il n’y a pas d’âge minimal, cela est laissé à la libre appréciation du juge (article 388-1 du Code civil).
Le juge devra alors vérifier que la parole de l’enfant n’est pas dictée par un adulte.
Peut-on payer le loyer de son enfant avec la pension alimentaire ?
Lorsqu’un couple se sépare, il doit prendre en compte les conséquences de cette rupture sur les enfants communs. Parmi ces conséquences, il y a le versement d’une pension alimentaire, qui vise à assurer le bien-être et l’épanouissement des enfants. Mais que se passe-t-il lorsque les enfants quittent le foyer familial pour vivre de manière autonome ? La pension alimentaire peut-elle servir à payer le loyer de son enfant ? Cet article présente les principes généraux de la pension alimentaire, ainsi que les cas particuliers où elle peut être utilisée pour financer le logement de son enfant.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
La pension alimentaire, un droit de l’enfant
La pension alimentaire est une somme d’argent versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne qui a la charge de l’enfant, pour contribuer à son entretien et à son éducation. La pension alimentaire est un droit de l’enfant, qui doit être respecté quelles que soient les circonstances. Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge aux affaires familiales, en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources des parents. La pension alimentaire est due jusqu’à ce que l’enfant soit indépendant financièrement, c’est-à-dire qu’il ait un emploi stable ou qu’il ait terminé ses études.
La pension alimentaire peut-elle servir à payer le loyer de son enfant ?
La pension alimentaire peut servir à payer le loyer de son enfant, si celui-ci n’habite plus chez ses parents et qu’il n’a pas les moyens de se loger. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, qui doit être justifiée par des raisons sérieuses, comme par exemple une rupture familiale, une formation éloignée du domicile parental, ou une situation de handicap. Le parent qui verse la pension alimentaire doit être informé du lieu de résidence de son enfant et du montant du loyer. Il peut demander au juge aux affaires familiales de modifier le montant de la pension alimentaire en fonction de l’évolution de la situation.
REFUS DE DIVORCER
En France il existe plusieurs types de divorce qui diffèrent selon le conflit d’espèce. On peut distinguer le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Il faudra donc étudier les conditions de chaque divorce pour engager la procédure adaptée à sa situation. Le divorce par consentement mutuel nécessite l’accord des deux parties tant sur le principe même du divorce que sur ses conséquences. Le divorce accepté quant à lui nécessite l’accord sur le principe même du divorce seulement. On peut donc, d’ores et déjà, éliminer ces deux types de divorce lorsqu’un des deux époux ne souhaite pas divorcer. En cas de désaccord de l’un des deux époux, l’autre pourra donc divorcer sur le fondement d’un divorce pour faute ou sur celui de l’altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est une procédure qui représente en moyenne 8 à 10% des divorces depuis la réforme du législateur en 2004. L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il est donc possible de reprocher certaines fautes à l’autre qui devront être prouvées à celui qui les impute. Le divorce pour faute nécessite que la faute soit qualifiée et qu’elle puisse être prouvée. En effet, le juge aux affaires familiales dispose du pouvoir de décider si la faute est caractérisée ou non en fonction des manquements à des devoirs attachés au mariage et/ou des comportements et aptitudes considérés comme illégitimes. Il n’y a pas de liste des comportements fautifs, c’est pour cela que le juge déterminera si le comportement de l’époux est fautif ou non. La preuve doit être caractérisée également et si elle ne l’est pas suffisamment et que le demandeur est dans l’impossibilité de soutenir sa demande, il se retrouvera dans une impasse. La situation la plus critique serait celle où le défendeur ne formulerait pas de demande reconventionnelle ou si celle-ci serait aussi insuffisamment argumentée. Dans ces cas, on pourrait voir le demandeur se faire débouter ainsi que le défendeur. Les avocats conseillent donc généralement à leur client, pour plus de sûreté, de laisser s’écouler le délai de deux ans pour pouvoir divorcer avec certitude pour altération définitive du lien conjugale.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Si l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de griefs particuliers contre son conjoint, il pourra opter pour ce type de divorce. Les articles 237 et 238 du Code civil régissent ce divorce dont le premier dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». L’article 234 rajoute que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». L’article 234 prévoit bien que les époux peuvent se fonder sur ce divorce si la séparation de deux ans est effective. Si ce n’est pas le cas, la date de la première audience dite de conciliation sera le point de départ du délai. L’époux qui souhaite divorcer devra donc prendre en compte ses éléments pour connaitre la meilleure procédure à engager. Pour l’aider, il peut prendre rendez-vous avec un avocat afin d’avoir les conseils appropriés et établir la meilleure stratégie pour obtenir un divorce qui lui sera favorable.
Bon à savoir : les époux peuvent recourir à la médiation familiale qui est un autre mode de règlement des conflits. Si le dialogue n’est pas totalement rompu, le médiateur tentera de trouver des accords sur les sujets conflictuels. La médiation familiale est une démarche libre et volontaire, elle suppose que les époux aient la volonté de trouver une solution à leur conflit plutôt que d’opter pour une procédure de divorce et donc une séparation définitive. Le coût d’une médiation est relativement faible et beaucoup moins élevé que celui d’une procédure de divorce. Toutefois il existe des médiateurs privés dont le montant des honoraires est variable.
Pourquoi deux avocats dans le divorce sans juge ?
DEUX AVOCATS DANS LE DIVORCE AMIABLE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 encadrant la procédure du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (Loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016, portant modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 nov.), l’article 229-1, alinéa 1er du Code Civil précise que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». Comme le prouve cet article, le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel constitue une révolution impliquant un changement de culture juridique et de pratique. A cet égard, l’évolution la plus significative par rapport à l’ancien divorce à l’amiable que l’on connaissait auparavant, est liée à l’obligation qui est faite à chaque époux d’être assisté et représenté de son propre avocat. Il n’y a donc plus de possibilité pour les époux d’être représentés par un seul avocat commun pour divorcer. Cette réalité résulte de la lettre de la loi et de son esprit : la volonté du législateur a été clairement de remplacer et de compenser le contrôle du juge aux affaires familiales par un autocontrôle de deux avocats. Ces derniers ont désormais une double fonction de contrôle-vérification et de protection des consentements anciennement confié au juge aux affaires familiales. C’est désormais à eux de s’assurer de l’intégrité du consentement des époux et de veiller à ce que les intérêts des parties, et des enfants le cas échéant, soient préservés.
Article lié: Les enfants et le divorce
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Tout divorce par consentement mutuel conventionnel sera donc engagé, accompagné, négocié et finalisé dans le moindre de ses détails par deux avocats et sous leur seule, unique et commune responsabilité. Les deux avocats devront veiller à tout moment à la réalité d’un consentement éclairé à la fois général et spécial. Ce binôme d’avocats est assez inédit dés lors qu’il est sans rattachement territorial nécessaire puisqu’il n’existe plus ni procédure ni instance. Il pourra s’agir d’un binôme de proximité mais aussi de binômes totalement mobiles à la faveur de la dématérialisation et des nouvelles technologies, avec cependant une interdiction impérative d’ordre public d’être dans le virtuel. Il ne saurait y avoir d’avocat pilote, voire dominant, mais bien deux conseils à égalité de compétence et de connaissance du fait de l’ensemble des questions de toute nature allant du droit international privé à la finesse de l’ensemble des questions patrimoniales et compensatoires en passant par une fine appréciation des enjeux d’ordre psychologique et humain, de l’organisation de la vie des enfants et plus largement de la famille se modifiant. Finalement, les deux avocats des époux doivent organiser véritablement la scénarisation de ce nouveau divorce par consentement mutuel afin que cela aboutisse au moment essentiel : la signature ensemble des époux et des avocats de la convention de divorce par consentement mutuel.
Que faire si son conjoint est dans le besoin pendant la procédure de divorce?
CONJOINT DANS LE BESOIN DURANT UN DIVORCE
Bon à savoir : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Tel prononcé, l’article 212 du Code civil met un point d’honneur à rappeler ce qui fait l’essence même du mariage. Ces devoirs continuent d’être exigés pendant la procédure de divorce et perdurent jusqu’au prononcé du divorce. Pour ce qui est du devoir de secours, l’objectif est de subvenir aux besoins de la vie courante, en particulier, maintenir un niveau d’existence semblable à celui de la communauté de vie découlant du mariage.
Comment définir les devoir de secours?
Dans les grandes lignes, il s’agit pour chacun des époux de fournir à l’autre tout ce qui semble nécessaire à son entretien. Sous la forme d’une pension alimentaire, cette contribution permet non seulement de subvenir aux besoins d’un des époux, mais également de lui garantir un niveau de vie similaire à celui du mariage. Elle s’impose dès lors qu’il existe une disparité dans les niveaux de vie des époux. Ces derniers doivent se mettre d’accord sur son montant dès lors qu’ils engagent une procédure de divorce par consentement mutuel. A défaut d’accord, cette procédure est susceptible d’évoluer en un divorce contentieux. L’état de besoin, le montant des ressources, sont souverainement appréciés par les juges du fond lors de l’ordonnance de conciliation (Civ. 2e, 10 juillet 1991) afin de déterminer le montant de la pension. Ils prennent en considération leurs revenus, leurs situations professionnelles, les éléments patrimoniaux et les possibilités de paiements de l’époux débiteur.
Article lié: Qu’est ce que le devoir de secours?
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.(…) suite de l’article
Mise en situation
Madame possède un revenu mensuel de 2500 euros, est propriétaire deux biens immobiliers en propre, et ne dispose d’aucun crédit. Monsieur possède un revenu mensuel de 1500 euros et aucun bien immobilier. Madame peut être tenu de verser une pension à Monsieur afin de maintenir son train de vie.A cet effet, l’article 208 du Code civil dispose que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ».Ladite pension n’est pas susceptible d’être supprimée tant que le lien conjugal n’est pas rompu par le jugement de divorce devenu définitif (Civ. 2, 10 octobre 1985). Étant donné qu’elle procède du seul devoir de secours, l’époux débiteur de la pension ne peut exiger le remboursement des arrérages (Civ. 1er, 30 juin 1998).
Existe-t’il une limite d’âge à la pension alimentaire ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
L’article 371-2 alinéa 1 du Code civil énonce que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette obligation a pour objectif de nourrir, entretenir et élever un enfant sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature de sa filiation c’est à dire qu’elle s’applique, indépendamment, que l’enfant soit né hors ou pendant le mariage, ou encore qu’il ait été adopté.
Définition
La pension alimentaire se définit comme une contribution financière accordée au parent qui a la charge de l’enfant afin qu’il puisse subvenir aux différents besoins de l’enfant de toute nature de la vie quotidienne. Par exemple, la pension alimentaire peut servir à l’habillement, au loisir, aux frais médicaux ou encore aux achats alimentaires de l’enfant.
Critère d’âge de l’enfant
L’article 371-2 alinéa 2 du Code civil précise que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.En effet, la pension alimentaire est versée jusqu’à ce que l’enfant, même majeur, acquiert une autonomie financière suffisante pour subvenir seul à ses besoins notamment grâce à l’exercice d’une activité, non occasionnelle, rémunérée. Ainsi, un enfant majeur engagé dans des études longues, un enfant atteint de handicap ou encore un enfant ayant le statut de majeur protégé, pourra soit bénéficier directement d’une pension alimentaire de la part de ses parents, soit le parent l’ayant toujours à sa charge continuera d’en bénéficier par l’autre parent. Il est important de préciser qu’un enfant majeur peut, de son propre chef, saisir le juge aux affaires familiales pour effectuer une demande de pension alimentaire dans le cas où les parents n’en prévoient pas.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Montant de la pension
Dans le cadre d’une procédure de divorce, il est régulier que les époux prévoient le versement d’une pension alimentaire.Si les époux décident d’engager une procédure de divorce devant le juge, c’est le juge aux affaires familiales qui fixe le montant de la pension alimentaire. Néanmoins, il est possible pour un parent être dispensé de verser une pension alimentaire dès lors qu’il apporte, au juge, la preuve de la précarité de sa situation financière précaire.Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, c’est aux époux de se mettre d’accord sur le montant de la pension alimentaire. Pour se faire, un barème est disponible sur le site du ministère de la justice afin d’aider les parents à fixer un montant équitable en fonction des critères pré-cités. Par ailleurs, il est important de préciser que la pension alimentaire sera indexée au 1er janvier de chaque année, sur l’indice national des prix à la consommation publié par l’INSEE.De plus, le montant de la pension alimentaire est révisable auprès du juge aux affaires familiales en cas de fait nouveau tel que la perte d’emploi ou encore l’augmentation des charges du parent en charge du versement.
Modalités de versement
En principe, le versement de la pension alimentaire est fixé par mois au parent ayant l’enfant à sa charge. Le montant varie en fonction du nombre d’enfants, des revenus et des charges du parent en charge de la verser mais aussi en fonction des besoins de ou des enfants. Cependant, il existe d’autres moyens de versement :
La pension peut être versée directement à l’enfant.
La pension peut se matérialiser sous forme d’une rente indexée dont la somme est gérée par un organisme financier.
L’attribution de biens productifs de revenus peut également être une modalité de versement de pension alimentaire.
Enfin, l’un des parents peut prendre en charge directement les frais de l’enfant. Pour se faire, il s’engage, par exemple, à financer, de lui-même, les frais liés à la scolarité, les frais médicaux, ou de loisirs de l’enfant